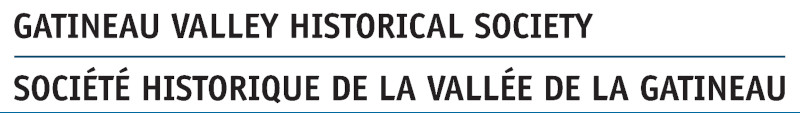Up the Gatineau! Articles
L'article suivant a été publié pour la première fois dans Up the Gatineau! Volume 51.
Article available in english
Le Projet Neufbourg: ils partagèrent un rêve, et firent de Cantley leur héritage
Michael Rosen
Pour la plupart des gens, l’idée d’amis aux mêmes goûts vivant ensemble à la campagne restera une simple fantaisie. Mais dans un petit coin de Cantley, huit familles ont décidé de réaliser leur rêve, en créant leur propre paradis, baptisé « Neufbourg » : une communauté qui était unique, et à bien des égards, en avance sur son temps.
Aujourd’hui, Place du Neufbourg ressemble aux autres rues du quartier. Ici, des maisons typiques des années 1980 sont disposées en cercle. La plupart des habitants ignorent sans doute l’esprit et les efforts qu’il a fallu pour bâtir cette communauté unique en son genre.
Arrivé à Cantley en 1995, j’étais désireux d’explorer le bois derrière mon paradis d’un acre. J’y découvris un étang creusé de grenouilles, une splendide cabane à sucre, et des plaques portant des noms d’arbres en français, et quelques-uns en latin. J’ai demandé à un voisin qui avait fait tout ça, et il me répondit : « Oh, c’est le Projet Neufbourg, c’est du monde spécial ».

De modestes débuts
Les Neufbourgeois étaient des gens spéciaux qui ont bâti une communauté rurale d’amis ayant des intérêts communs. L’histoire commence vers le milieu des années 70 quand trois couples dans la fin quarantaine, originaires de Gatineau, Sherbrooke et Montréal, eurent l’idée de vivre ensemble. Enfants de la Révolution tranquille1, farouchement nationalistes, fiers d’être francophones, et croyants aussi, leur foi catholique étant pour eux un moyen d’aider la société. Deux des fondateurs, Marc-André Tardif et Bernard Bouthillette, étaient d’anciens prêtres mariés à d’anciennes religieuses. Tardif était à bien des égards le chef spirituel du groupe. En 2017, à 90 ans, il écrivit l’histoire définitive de la communauté, Le Projet Neufbourg. Cet article s’en inspire largement. Quant à lui, Bouthillette deviendra le premier maire de Cantley.
En 1976, avec quatre enfants sur les bras, ils achetèrent à Aylmer une maison des années 1850, chaque famille ayant son étage. Les tâches ménagères étaient partagées : le soin des enfants, les courses, le lavage, etc. La maison devint une sorte de centre spirituel et culturel. Les visiteurs étaient nombreux, certains associés à L’Arche, organisme chargé d’accueillir des personnes ayant une déficience intellectuelle. Certains finiront par déménager à Cantley.

Déménagement à Cantley
Après deux ans à Aylmer, ils songent à établir la communauté dans un milieu rural. Certains couples étaient déjà de Cantley, mais ils virent de l’avenir dans ce « bourg » encore inconnu de Gatineau, Cantley en faisant alors partie. Tardif et Bouthillette achetèrent 17 acres au prix de 61 444 $, donnant au projet et à la rue le nom de « Neufbourg », d’après une commune de France. « Neuf » pour traduire sa création récente, et « bourg », au sens de village. « Aide mutuelle, partage, croissance personnelle et spiritualité2 », tels devaient être les fondements de la communauté.
En 1978, Cantley était différent d’aujourd’hui. Avec quelque 3 000 âmes, la population était francophone à 60%; aujourd’hui, les 12 000 habitants le sont à 85%. Le principal lien routier, la route 307, était asphaltée depuis à peine 10 ans. Trois ans auparavant, en 1975, la ville de Gatineau était créée à partir de sept municipalités, dont Cantley représentait 7% de la population. Dès la création de Neufbourg, cette fusion avait suscité de la grogne chez les Cantleyens, et en moins de 10 ans, la municipalité se séparait de Gatineau, sous l’influence dominante de la communauté de Neufbourg.


Le début des travaux
Priorité aux infrastructures – des routes3, un ponceau pour canaliser un cours d’eau, des puits, l’électricité – alors que les familles vivaient en partie sous la tente ou dans une remorque. C’était un effort colossal. Le plan original était un bâtiment à plusieurs unités, avec sous-sol, puits et fosse septique communs. Mais la ville de Gatineau ne voulait rien savoir. « Une maison sur un acre » était le mantra de la planification rurale. C’est toujours la règle à Cantley aujourd’hui, mais elle est contestée en partie pour des besoins de densification et en partie pour permettre des bâtiments à unités multiples du genre que proposait Neufbourg.
Gatineau accepta un plan révisé pour Neufbourg : sept propriétés distinctes, comme des pointes de pizza disposées en cercle, chacune avec un puits, une fosse septique et un parc commun au milieu. Après l’arpentage réglementaire, un plan d’ingénieur et l’arrivée de l’électricité, le prix des lots était fixé à 8 000 $. En 1979, quatre couples (et cinq enfants) y habitaient.
Léo Maisonneuve, Cantleyen de longue date et conseiller municipal à deux reprises, était impressionné par l'énergie du groupe. Dans une conversation récente, il me rappelait cette observation de l'épouse de Bouthillette, Claudette Dionne: "Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes".

Avec l’arrivée de quatre couples et leurs enfants, cela faisait huit familles. En 1985, toutes les maisons étaient bâties, et le parc était complet, avec balançoires, filet de badminton et piscine hors terre. Chaque famille versait une contribution mensuelle symbolique pour l’entretien du parc4.
Très rapidement la rumeur publique parlait de « monde différent » et d’« idées différentes ». Des employés municipaux les accueillaient en leur disant « Comment va la commune? »; d’autres parlaient d’« échanges de partenaires ». Certains Neufbourgeois trouvaient ça difficile à avaler. Tardif expliquait aux moqueurs que si la communauté avait une vision commune, c’était loin d’être une « commune », ce qui finit par décourager les plaisanteries.
La Charte de Place Neufbourg
En 1979, la Charte de Neufbourg vit le jour, et fut lue et signée par les membres, et un groupe de propriétaires fut créé, « L’Association des propriétaires de Neufbourg ». Comme l’écrivait Tardif, « l’esprit qui guide cet accord se résume à quelques principes : qualité de vie, partage, aide mutuelle, esprit communautaire, accueil indépendamment du sexe, des croyances religieuses, des opinions politiques, des biens ou de l’âge (importance de la participation des enfants) ».
La Charte comptait 10 sections, dont des sujets comme la recherche de consensus, un comité exécutif, l’interdiction de clôtures entre les propriétés et le partage des tâches communes. Fait intéressant, la Charte précisait que « les enfants demeurent toujours la responsabilité de leurs parents, mais cela n’empêche pas les autres parents de donner leur avis de temps en temps ».

Cabane à sucre et parc communautaire
La cabane à sucre derrière chez les Tardif était l’attrait du coin. Tardif avait choisi un terrain rocheux surtout parce qu’il s’y trouvait le plus d’érables à sucre. En mars, il se chargeait de la collecte et de l’ébullition de la sève de ses érables à 120 entailles – en hommage à ses racines beauceronnes. Cela était souvent suivi de soupers canadiens, avec jambon fumé, fèves au lard, salades, et la précieuse tire.
Le parc communautaire au centre joua un rôle important dans la vie des gens. On y tint de nombreuses fêtes, dont des pique-niques auxquels on invitait des amis. Ce fut un triste rappel de la fin de Neufbourg le jour où le parc a été vendu en 2007 et qu’on y bâtit une maison.
Neufbourg et la naissance de Cantley
Neufbourg prenait à peine forme que la municipalité de Cantley se disait insatisfaite de la ville de Gatineau. Perte de l’identité rurale, fardeau fiscal accru, possibilité qu’une décharge publique de Gatineau se retrouve à Cantley, tout cela poussa les Cantleyens à militer pour leur indépendance.
La chose n’était pas facile, plusieurs prenant des initiatives et travaillant de longues heures. Pour Steve Harris, qui sera maire de Cantley (2005-2013), la communauté Neufbourg pouvait être utile dans la création de la nouvelle municipalité. « Je me souviens d’une réunion dans le sous-sol de Bernard Bouthillette et Claudette Dionne, dit-il, pour définir la stratégie de la séparation d’avec Gatineau. » « Pour Bouthillette, son expérience de la création de Neufbourg pouvait être utile dans le cas de Cantley. »
L’ancien conseiller Léo Maisonneuve participait à ces réunions chez les Bouthillette/Dionne. Il fait cette observation : « Je me souviens que les propriétés étaient particulièrement bien tenues. » Dix ans après la création ce Neufbourg, Cantley finit par se séparer de Gatineau, et Bouthillette fut élu comme son premier maire.
Neufbourg et l’Église

La spiritualité a toujours été partie intégrante de Neufbourg, la plupart des habitants étant membres de l’Église catholique. Sur les huit familles, trois couples étaient d’anciens prêtres et sœurs. De sorte que certains désignaient la communauté comme la « gang des anciens prêtres et sœurs ».
Les Neufbourgeois étaient des idéalistes – qui avaient à cœur les gens et l’environnement. Plusieurs étaient des enseignants, certains ayant été missionnaires en Afrique. À bien des égards, ils projetaient l’image stimulante d’un nouveau catholicisme : humanitaire, moderne, au service de la communauté.
À la fin des années 90, en tant que bénévole d’un organisme catholique pour immigrants, Tardif frappait à ma porte avec de nouveaux immigrants yougoslaves qui étaient des forestiers (je suis moi-même forestier). Rendus apatrides par la guerre civile, ils étaient impatients de se trouver un emploi au Canada. La compassion dont Tardif faisait montre était impressionnante.
Et après la chute du cruel régime Duvalier en Haïti au milieu des années 80, un des couples de Neufbourg, Benoît Bégin et Hélène Kelly, mit sur pied un organisme de charité, Solidarité-Haïti (https://solidaritéhaïti.org/), qui avait l’appui de la plupart des Neufbourgeois.
Une fois déménagée à Cantley, la communauté s’intéressa de près à l’Église catholique de l’endroit, Sainte-Élisabeth (ou St. Elizabeth). Fondée par la population anglophone en 1868, l’église tentait d’affirmer sa présence dans un milieu de plus en plus francophone. Le groupe Neufbourg s’employa à la moderniser en donnant une orientation plus francophone à sa messe, sa liturgie et sa culture. Devant une certaine résistance au début, des messes distinctes furent dites en anglais et en français, et puis on recruta des prêtres bilingues.
Neufbourg atteint sa maturité



La suite fut 20 ans de bonheur presque ininterrompu, ponctués d’une série de fêtes presque interminable : les 10e et 20e anniversaires de Neufbourg, en 1989 et 1999, la Journée internationale de la femme le 8 mars (les hommes se chargeant des « agapes »), la Fête des Rois5, avec costumes médiévaux et proclamations, la Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, et d’innombrables soupers, fêtes et anniversaires.
Charles Belle-Isle avait 12 ans quand il arriva à Neufbourg avec ses parents en 1980. Comme la plupart des résidents, il ne se souvient pas de véritables conflits dans la communauté. « Ma mère était trésorière, et il lui arrivait de se plaindre du retard dans les frais mensuels pour l’entretien du parc, mais ce n’était vraiment rien », dit-il. Charles a encore la liste des membres de la communauté – parents, enfants et, aujourd’hui, petits-enfants. En 2025, 12 des 16 premiers adultes étaient encore en vie, ainsi que 10 enfants et 12 petits-enfants. De dire Charles, les funérailles de Marc-André en 2021 marquait la fin d’un grand chapitre pour la communauté, la plupart de ceux qui en avaient fait partie ayant déménagé.
L’héritage de Neufbourg
Après presque 50 ans, l’héritage du projet Neufbourg à Cantley ne fait pas de doute : du « coin perdu » qu’elle était, Cantley est devenue une communauté québécoise moderne. L’influence neufbourgeoise a été considérable : création de la municipalité de Cantley, élection d’un des fondateurs comme premier maire, contribution à la modernisation de la paroisse de Sainte-Élisabeth, valorisation de l’église et recrutement de nouveaux membres.

Mais tout ne s’est pas passé comme on l’espérait. En évaluant ce qu’est devenue Cantley, un des premiers membres de Neufbourg, Lucie Smeltzer, émet une réserve. « Je ne suis pas sûre de ce qu’est devenue Cantley à long terme, me dit-elle. Nous pensions tous, je crois, que Cantley allait se donner une vision rurale plus cohérente que ce ne fut le cas. »
Comme Marc-André le note dans Le Projet Neufbourg, les choses ont une fin ou elles changent. Dès les années 1990, les premiers résidents ont commencé à partir, souvent pour se rapprocher de parents vieillissants ou de petits-enfants. Il y eut inévitablement des décès. En 2003, il ne restait que deux des huit familles d’origine. La Charte de Neufbourg et l’association des propriétaires tombèrent dans l’oubli.
En 2022, les tout derniers résidents d’origine, Michel Legault et Lucie Smeltzer, déménagèrent à Hull et vendirent leur maison à leur fils Martin, qui est le dernier Neufbourgeois d’origine. Martin n’a que de merveilleux souvenirs : « Nous partagions presque tout à Neufbourg – les pintes de lait, le tracteur de pelouse, la voiture. J’ai grandi en croyant que tout le monde faisait ça. Ce n’est qu’une fois à l’école que j’ai réalisé que la plupart des gens avaient une clôture, et ne connaissaient pas leurs voisins. »
L’approche du 50e anniversaire de Neufbourg en 2029 soulève beaucoup d’espoir : la tenue d’une réunion, la désignation du ruisseau qui traverse le terrain comme le Ruisseau Neufbourg, et la possibilité de l’installation d’une plaque historique sur place pour marquer la contribution de cette communauté unique et remarquable.
L’auteur tient à remercier la communauté de Neufbourg pour son aide et sa collaboration dans la rédaction de cet article – particulièrement Benoit Bégin, Charles Belle-Isle, Martin Legault, Michel Legault et Lucie Smeltzer.
Footnotes
- La “Révolution tranquille” caractérise les changements dramatiques survenus dans la société québécoise dans les années 60, tels que la perte d’influence de l’Église catholique, la montée du nationalisme économique (“maîtres chez nous”) et la promotion de la langue française.
- Marc-André Tardif, Le Projet Neufbourg, Archives nationales du Québec, 2017.
- L’autoroute 307 servait d’accès à l’époque, mais craignant des problèmes de circulation, la communauté acheta un autre lot rue Bouchette (de M. Lizotte), évitant ainsi d’avoir à passer par l’autoroute.
- Communication personnelle avec Charles Belle-Isle, le 23 janvier 2025.
- La “Fête des Rois” (ou l’Épiphanìe), célébrée le 6 janvier, surtout en Europe, rend hommage aux trois Rois mages venus présenter les premiers cadeaux à l’Enfant Jésus (de l’or, de l’encens et de la myrrhe).
Références
La Paroisse catholique de Ste-Élisabeth de Cantley, Québec/The Parish of the Roman Catholic Church of Cantley, Québec. Histoire des curés de la paroisse catholique de Ste-Élisabeth de Cantley au Québec/History of the parish priests of St. Elizabeth’s Roman Catholic Church of Cantley, Québec. D’après des recherches du Père Cornelius Boekema, C.S.Sp. Publié par Lenora Chamaillard, 1983.
Tardif, Marc-André. Le Projet Neufbourg. Archives Nationales du Québec, INSN-978-2-9803561-7-4, 2017.